|
L’utilisation du tour permet d’obtenir des formes
circulaires régulières.
Le tour du potier, apparu au IVe millénaire av. J.-C., se compose d’un
plateau rotatif appelé girelle.
Après avoir disposé une motte d’argile au centre du plateau, le potier
place ses mains de part et d’autre de la paroi de l’objet afin de le
façonner. Certains tours fonctionnent à l’aide d’un manche fixé dans une
encoche et souvent actionné par l’assistant du maître potier.
Appelé tour à main, ce modèle est principalement utilisé par les potiers
japonais.
Au XVIe siècle, en Europe, le tour a été complété par un volant séparé de
la girelle et fixé sur un cadre.
Actionné au pied, ce volant permet au potier de contrôler la vitesse de
rotation du tour.
La pédale fait son apparition au XIXe siècle. Au XXe siècle, la mise au
point du tour
électrique permet au potier de régler avec plus de précision la vitesse de
la girelle.
L'industrialisation de la production fit apparaître le moulage à la
chaîne.
Telle la chaîne dite "Tracassin" aux faïenceries de Salins-les-Bains.
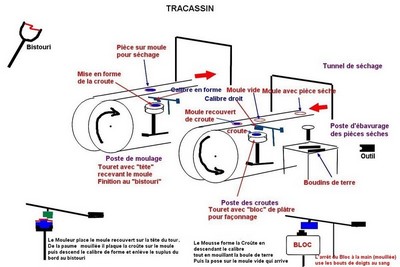
Cliquez pour agrandir
Sorte de doubles chenilles. Un tunnel de séchage sépare les
deux ensembles de production. Chaque poste d'extrémité se compose :
-
D'un tour d'ébavurage.
L'ouvrier récupère les pièces séchées et enlève la bavure du bord,
donnant une finition arrondie et lisse. Les pièces partiront en première
cuisson – création du biscuit – puis au "décor", "émaillage" et
"cuisson" finale.
-
D'un tour
confectionnant les "croûtes". D'une portion de "terre" jetée au
centre du bloc, le "mousse" façonne une croûte plane de 5/6 mm
d'épaisseur en abaissant un "calibre" tout en mouillant la pièce, puis
dépose celle-ci – en la retournant – sur le moule vidé par l'ébavurage.
-
D'un tour de "moulage".
Le mouleur façonne la pièce sur le moule en donnant le relief externe
avec le "calibre de forme". Puis l'envoie au séchage.
Ces opérations "à la
chaîne" ne prennent que quelques secondes.
|

